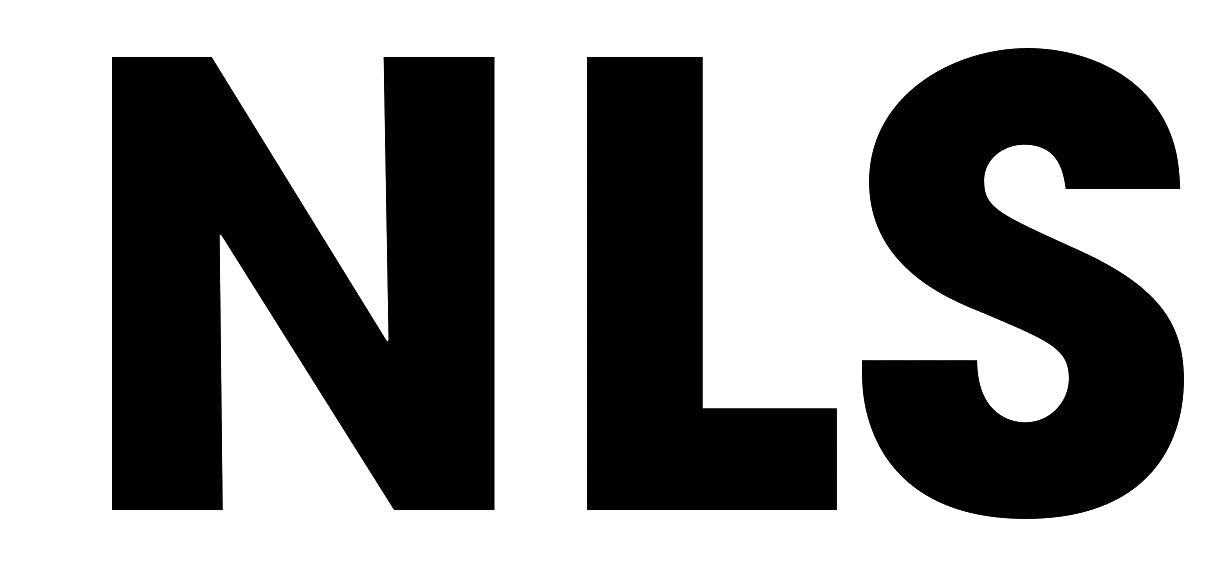La Nost-algie du déraciné
Nassia Linardou
Le 24 septembre 1922, après la défaite de l’armée grecque en Anatolie et le grand incendie de Smyrne, l’hebdomadaire parisien Le Petit Journal illustré publie en première page une lithographie. Elle montre les éléments de l’événement traumatique qui restera gravé dans les mémoires grecques comme La Catastrophe. On y voit les soldats grecs effondrés, les réfugiés terrorisés portant enfants et bagages à bout de bras et, au loin derrière, la ville en feu. Sur les terres des empires à l’agonie, les populations mélangées qui y vivaient se séparent dans la haine et le sang.
Pour les Grecs, trois mille ans de présence ininterrompue en Ionie prenaient fin dans le carnage. Si Freud dans la lettre à Einstein conclut que « tout ce qui travaille pour la culture travaille aussi contre la guerre [1]», le poète Georges Séféris, né à Smyrne en 1900, fait le chemin à rebours sous le choc du bruit et de la fureur de l’Histoire. Il écrit à sa sœur : « Smyrne, la Grèce, les trahisons, les égorgements, les viols, toute la honte et le mépris de l’être civilisé m’ont dépouillé de tout. […] Je ne te parlerai pas d’art en ce moment. Il y a quelque chose de supérieur à l’art : le malheur congénital, la rumeur incessante, continue, du cœur du monde, qui n’accorde aucun répit. [2]» Sa poésie portera la trace de ce trauma qui aura violemment contraint le pays à changer de discours et à faire son entrée dans la modernité. Elle se tissera autour de la blessure de La Catastrophe et voudra pallier le Nostos irrémédiable.
Déracinement a souvent été la métonymie utilisée pour qualifier le malheur qui avait frappé plus d’1 000 000 de fugitifs d’Asie Mineure, du Pont-Euxin et de la Thrace orientale, réfugiés en Grèce helladique en ce début du siècle dernier. « Ce qui m’a aidé plus que tout, écrit G. Séféris en 1966, fut mon attachement confiant à un univers de vivants et de morts, à leurs œuvres, à leur voix, à leur rythme […]. Cela m’a permis de comprendre, quand j’ai revu la terre qui m’a donné le jour, que l’homme a des racines et s’il en a été coupé, il souffrira au vif de sa chair [3]».
Diplomate en poste à Ankara, il décide à 50 ans de rentrer dans sa « patrie ». Le retour à ses racines lui provoque un vif sentiment d’Unheimlichkeit : « un mélange de complète familiarité avec le lieu allant de pair avec le sentiment d’une exclusion totale, d’un engloutissement définitif [4]». Il compare cette « attirance vers sa terre » à la faim, au désir amoureux. Dans son Journal, il retrace le travail de séparation d’avec le cosmos de son enfance comme un va-et-vient entre l’exclusion et la familiarité « physiologique ». La séparation n’est pas sans reste. Quittant Smyrne, ville aimée où il ne retournera plus, il écrit la phrase terrible suivante : « En sortant, j’ai compris pourquoi la femme de Loth fut changée en statue de sel lorsqu’elle regarda derrière elle [5]». Quand l’Idéal de la Grande Idée s’est pour les Grecs effondré de la scène de l’histoire, G. Séféris a « supporté la vie [6]» par la force de sa poésie. Sublimation du trauma, la poésie loge pour ce déraciné une langue superbe, par laquelle il a pris place dans l’oïkoumène du discours.
Références
[1] Einstein A., Freud S., Pourquoi la guerre, Paris, Payot-Rivages, 2005, p. 64.
[2] Kohler D., Georges Séféris, Lyon, La Manufacture, 1989, p. 51.
[3] Séféris G., Essais, t. ii, (1948-1971), Athènes, Ikaros, 1974, p. 176 (en grec, traduit par l’auteure).
[4] Séféris G., Journal, t. v, (1945-1951), Athènes, Ikaros, 1973, p. 192-203 (en grec, traduit par l’auteure).
[5] Ibid., p. 203.
[6] Freud S., « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », Essais de psychanalyse, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 1984, p. 40.